A BOOK TO READ ABSOLUTELY THAT EXPLAINS HOW MANSA MUSA CAUSED THE COVETOUSNESS OF AFRICA BY EUROPEANS ! UN LIVRE À LIRE ABSOLUMENT QUI EXPLIQUE COMMENT KANKAN MOUSSA A CAUSÉ LA CONVOITISE DE L’AFRIQUE PAR LES EUROPÉENS !
This is the
original article as it appeared in the New-York Times
Africa, Africans, and the Making of the
Modern World, 1471 to the Second World War
By Howard W. French
In 1444, the citizens of Lagos in southern
Portugal witnessed a novel spectacle. As they crowded the beach, some 235 newly
arrived Black captives were driven ashore. Overseers dragged families apart as
despairing mothers clutched their children and threw themselves on the ground,
absorbing the blows raining on their backs. Presiding from horseback over
Europe’s first sizable market of sub-Saharan slaves was Portugal’s Prince
Henry, known to history as “the Navigator,” and watching nearby was his
official biographer, Gomes Eanes de Zurara. Abandoning his usual sycophancy in
the face of the captives’ anguish, Zurara bitterly protested that he could not
help but “cry piteously over their suffering” and found scant comfort in the
thought that their heathen souls, if not their scarred bodies, would be saved.
As Howard French painfully establishes, the
Portuguese would soon get used to such sights, and the slavers’ unholy swindle
— a lifetime of hard labor in return for a shot at the afterlife — would be
trundled out across four centuries to justify the shipment of 12.5 million
Black bodies to the New World. In “Born in Blackness,” French’s design is not
to elicit revulsion — though scenes of enslaved people feeding hellish sugar
cane furnaces and slopping manure into dunging holes certainly do that — but to
fill an Africa-size hole in conventional accounts of the Age of Discovery and
the rise of the West.
In place of Spain and Columbus, French, a
former Africa correspondent for The New York Times, proposes Portugal as the
true engine of modernity through its deep involvement in sub-Saharan Africa.
This may surprise some readers, since Portugal during this period is chiefly
remembered for Vasco da Gama’s 1498 voyage around Africa to India. For much of
the 15th century, though, Portugal had expended its scant resources on
exploring the West African coast. Far from being a giant obstacle standing
between Europe and the luxury goods of India and China, Africa had its own
allurements, and foremost among them was gold.
Medieval Europeans awoke to the possibility
of untold African wealth when reports reached them of an impossibly magnificent
expedition mounted by an emperor of Mali. That emperor, Mansa Musa, set out in
1324 on a pilgrimage to Mecca with an entourage 60,000 strong — among them
12,000 slaves — dispensing sacks of gold as he went, including more than 400
pounds to the sultan in Cairo. His trip was the talk of the century, and it lit
the imagination of specie-poor Europe. A heavily crowned Mansa Musa was depicted
on one 1375 map extending a huge nugget of gold. “This king is the richest and
noblest of all these lands," the legend read, “due to the abundance of
gold that is extracted from his lands.” Some said he was the richest king in
the history of the world.
French
proposes this royal spectacular as the motive force in the creation of the
Western world. The prospect of directly tapping African gold by skirting the
traders of Islamic North Africa was certainly high on Henry the Navigator’s
list. Yet by the time gold was found in quantity (in 1471, the year French
takes as the starting date of Africa’s entry into modernity, with the
Portuguese fort at Elmina in modern-day Ghana as its key locus), Henry was long
dead. Instead, it was slaving that saved his skin, and slaves would soon
outstrip gold as the most valuable commodity in Europe’s expanding Atlantic
sphere.
To the
colonialists, it was all one intoxicating rush of wealth. African laborers, or
“black gold,” arduously cultivated sugar cane, or “green gold,” and later
cotton, or white gold, all of which transmuted into real gold. Once again, it
was the Portuguese who took the lead, modeling Black plantation slavery first
on the islands of Madeira and São Tomé, and then on an epic scale in Brazil. If
the Spanish found much of the New World and imported the diseases that
depopulated it, French argues, the Portuguese discovery in Africa of the means
to exploit it surpassed and outlasted Spain’s mining frenzy as a productive
economic activity. The Portuguese model was adopted in turn by the Dutch,
French and British, who refined it on Barbados into a cruelly efficient system
of profiteering that gave owners near total control over their captives’ lives
and allowed even murder to go unpunished. The net economic value of plantation
slavery has been much debated: French cites compelling research but falls back
on his (surely correct) intuition that rival powers would scarcely have spilled
so much blood and treasure in their interminable battles to control Black labor
if the margins at stake were thin.
“Born in
Blackness” is laced with arresting nuggets. It was news to me that the trade of
colonial North America was overwhelmingly directed toward the Caribbean, “the
boiler room of the North Atlantic economy.” In the late 18th century, white
Jamaicans enjoyed an annual income 35 times that of British North Americans.
French notes that more slaves were trafficked to Martinique, less than
one-quarter the size of Long Island, than to the entire United States, while
the French so prized tiny Guadeloupe that they swapped it for the whole of
French Canada. The evidence that Africans made the New World economically
viable is overwhelming, but in his zeal to press his point, French sometimes
goes for broke. He variously traces a more or less straight line from
plantation agriculture to the division of labor, productivity metrics, the
birth of large corporations, the emergence of commercial credit and capitalism,
coffeehouse culture and newspapers, political engagement and pluralism, the
English Civil War, the Glorious Revolution, the Industrial Revolution and the
Enlightenment.
This is
stretching a case well made. “Born in Blackness” is filled with pain, but also
with pride: pride at the endurance of oppressed millions, at the many slave
uprisings and rebellions culminating in the Haitian revolution, which defeated
“the idea of Black slavery itself,” and in the cultural riches of the African
diaspora. Some of the most illuminating chapters deal with the nations of
Africa themselves: polities such as Benin, Kongo and Mali that featured
thriving urban centers, exquisite artisanship and legal and administrative
systems on a par with much of medieval Europe. Early on, Portugal discovered
the folly of sending soldiers charging up beaches in plate armor and changed
tack to making alliances, transacting with informed and eloquent African
leaders largely as equals and outsourcing the deadly business of capturing
humans for enslavement. Remarkably, no African state would be conquered by Europeans
until the 19th century; our modern image of the continent dates from 1885, when
the imperial powers divvied it up, creating arbitrary, dysfunctional countries
that have stuck. “Africans themselves,” French acerbically notes, “were not
consulted.”
French does
not shy away from the ruthless complicity of many African leaders in the slave
trade, which he blames on the lack of a unifying African identity and a raging
thirst for imported silks, palanquins, guns and the rum produced in Brazil by
their former brethren. He maps out the shattering cost in depopulation, chaotic
regional wars, internal displacement, the erosion of social trust and the
unquantifiable legacy that he movingly describes as “the haunting echo of a
wound that one carries down through the generations.”
“Born in
Blackness” is enlivened with personal anecdotes, but readers looking for a
gripping narrative will be disappointed. French repeatedly circles back over
his material like a picture restorer revealing a lost world as he calmly insists
that we rewrite history. I found the book to be searing, humbling and essential
reading.
Ci-dessous est la traduction de
l’article original tel qu’il est paru dans le New-York Times
BORN IN BLACKNESS (NÉ DANS LA NÉGRITUDE)
L’Afrique, les Africains et la création
du monde moderne, de 1471 à la Seconde Guerre mondiale
Par Howard
W. French
En 1444, les citoyens de Lagos, dans le
sud du Portugal, assistèrent à un nouveau spectacle. Alors qu’ils étaient entassés
sur la plage, quelque 235 captifs noirs nouvellement arrivés ont été débarqués.
Les superviseurs séparèrent les familles captives alors que des mères
désespérées serraient leurs enfants dans leurs bras et se jetaient par terre,
absorbant les coups qui pleuvaient sur leur dos. Manageant à cheval le premier
grand marché d’esclaves subsahariens d’Europe, était le prince Henri du
Portugal, connu dans l’histoire sous le pseudonyme de « le
navigateur », et regardant à proximité était son biographe officiel, Gomes
Eanes de Zurara. Abandonnant ses dithyrambes habituels face à l’angoisse des
captifs, Zurara protesta amèrement qu’il ne pouvait s’empêcher de « pleurer
pitoyablement sur leur souffrance » et trouva peu de réconfort dans l’idée que
leurs âmes païennes, sinon leurs corps meurtris, seraient sauvés.
Comme Howard French l’établit
douloureusement, les Portugais s’habitueraient bientôt à de tels spectacles, et
de l’escroquerie impie des esclavagistes – une vie de dur labeur en échange
d’une promesse de bonheur dans l’au-delà – seraient étalés à travers quatre
siècles pour justifier l’expédition de 12,5 millions de corps noirs vers le
Nouveau Monde. Dans « Born in Blackness », le dessein de French n’est
pas de susciter la répulsion - bien que les scènes de personnes asservies
nourrissant des fours de canne à sucre et glissant des excréments dans des
trous pour en faire du fumier, le fassent certainement - mais il vient combler
un trou de la taille dans les récits conventionnels de l’Afrique de l’ère de la
découverte et de la montée de l’Occident.
À la place de l’Espagne et de
Christophe Colomb, French, un ancien correspondant Afrique du New York Times,
propose le Portugal comme véritable moteur de la modernité grâce à son
implication profonde en Afrique subsaharienne. Cela peut surprendre certains lecteurs,
car le Portugal de cette période est principalement connu pour le voyage de
Vasco de Gama en 1498 contournant l’Afrique pour aller en Inde. Pendant une
grande partie du 15ème siècle, cependant, le Portugal avait dépensé ses maigres
ressources pour explorer la côte ouest-africaine. Loin d’être un obstacle géant
entre l’Europe et les produits de luxe de l’Inde et de la Chine, l’Afrique
avait ses propres attraits, et le plus important d’entre eux était l’or.
Les Européens médiévaux se sont intéressés
à la possibilité d’une richesse africaine intarissable lorsque des rapports
leur sont parvenus d’une expédition incroyablement spectaculaire organisée par
un empereur du Mali. Cet empereur, Kankan Mousa, partit en pèlerinage en 1324 à
La Mecque avec un entourage de 60000 personnes – dont 12000 esclaves –
distribuant des sacs d’or au fur et à mesure que sa caravane avançait, dont
plus de 400 livres (environ 200 kilogrammes) au sultan au Caire. Son voyage a
été le sujet de conversation du siècle, et il a enflammé l’imagination de
l’Europe pauvre. Un Kankan Moussa lourdement couronné a été représenté sur une
carte de 1375 offrant une énorme pépite d’or. « Ce roi est le plus riche et le
plus noble de toutes ces terres », lit-on dans la légende, « en raison de
l’abondance d’or qui est extrait de ses terres. » Certains disent qu’il reste
le roi le plus riche de toute l’histoire du monde.
French propose ce spectaculaire voyage
royal comme force motrice dans la création du monde occidental. La perspective
d’exploiter directement l’or africain en contournant les commerçants de
l’Afrique du Nord islamique figurait certainement en bonne place sur la liste
d’Henri le Navigateur. Pourtant, au moment où l’or a été trouvé en quantité (en
1471, l’année que French prend comme date de début de l’entrée de l’Afrique
dans la modernité, avec le fort portugais d’Elmina dans le Ghana moderne comme
lieu clé), Henri aurait déjà été mort depuis longtemps. Au lieu de cela, c’est
l’esclavage qui a sauvé sa peau, et les esclaves allaient bientôt dépasser l’or
en tant que marchandise la plus précieuse dans la sphère atlantique en
expansion de l’Europe.
Pour les colonialistes, tout cela
n’était qu’une ruée enivrante de richesse. Les travailleurs africains, ou
« or noir », cultivaient péniblement la canne à sucre, ou « l’or
vert », et plus tard le coton, ou l’or blanc, qui se sont tous transmutés
en or véritable. Une fois de plus, ce sont les Portugais qui ont pris les
devants, expérimentant l’esclavage noir dans des plantations d’abord sur les
îles de Madère et de São Tomé, puis à une échelle épique au Brésil. Si les
Espagnols ont trouvé une grande partie du Nouveau Monde et importé les maladies
qui l’ont dépeuplé, French soutient que la découverte portugaise en Afrique des
moyens de l’exploiter a dépassé et survécu à la frénésie minière de l’Espagne
en tant qu’activité économique productive. Le modèle portugais a été adopté tour
à tour par les Hollandais, les Français et les Britanniques, qui l’ont affiné à
la Barbade en un système cruellement efficace de profit qui donnait aux
propriétaires un contrôle presque total sur la vie de leurs captifs et
permettait même aux meurtres de rester impunis. La valeur économique nette de
l’esclavage dans les plantations a fait l’objet de nombreux débats : French
cite des recherches convaincantes, mais s’en tient à son intuition (sûrement
correcte) selon laquelle les puissances rivales n’auraient guère versé autant
de sang et de trésoreries dans leurs interminables batailles pour contrôler le
travail noir si les marges en jeu étaient minces.
« Born in Blackness » est
truffé de pépites saisissantes. C’était nouveau pour moi d’apprendre que le
commerce de l’Amérique du Nord coloniale était massivement dirigé vers les
Caraïbes, « la plaque tournante de l’économie de l’Atlantique Nord ». À la fin du 18e siècle, les Jamaïcains
blancs jouissaient d’un revenu annuel 35 fois supérieur à celui des
Nord-Américains britanniques. French note que plus d’esclaves ont été expédiés
en Martinique, qui fait moins du quart de la taille de Long Island, qu’à l’ensemble
des États-Unis, tandis que les Français évaluaient si précieusement la
minuscule Guadeloupe qu’ils l’ont échangée contre l’ensemble du Canada français
(dans le traité de Paris de 1763, qui mit fin à la guerre de Sept Ans, ils
abandonnèrent tout le Canada pour pouvoir conserver la Martinique ainsi que
l’île voisine de la Guadeloupe). Les preuves que les Africains ont rendu
le Nouveau Monde économiquement viable sont accablantes, mais dans son zèle à
faire valoir son point de vue, French va parfois trop loin. Il trace
diversement une ligne plus ou moins droite de l’agriculture de plantation à la
division du travail, aux mesures de productivité, à la naissance des grandes
entreprises, à l’émergence du crédit commercial et du capitalisme, à la culture
des cafés, et aux journaux, à l’engagement politique et au pluralisme, à la
guerre civile anglaise, à la glorieuse révolution, à la révolution industrielle
et au siècle des Lumières.
C’est exagérer un cas déjà convainquant.
« Born in Blackness » est rempli de douleur, mais aussi de fierté : fierté de
l’endurance de millions de personnes opprimées, des nombreux soulèvements et
rébellions d’esclaves qui ont culminé avec la révolution haïtienne, qui a
vaincu « l’idée même de la traite des noirs», et dans les richesses culturelles
de la diaspora africaine. Certains des chapitres les plus éclairants traitent
des nations d’Afrique: des royaumes tels que le Bénin, le Kongo et le Mali qui
comportaient des centres urbains florissants, un artisanat exquis et des
systèmes juridiques et administratifs comparables à une grande partie de
l’Europe médiévale. Très tôt, le Portugal a découvert la folie d’envoyer des
soldats charger des plages en armure de métal et a changé de tactique pour
faire des alliances, en négociant avec des dirigeants africains informés et
éloquents qui étaient en grande partie leurs égaux et en sous-traitant
l’entreprise mortelle de capture d’humains pour l’esclavage. Remarquablement,
aucun État africain ne serait conquis par les Européens avant le 19ème siècle ;
notre image moderne du continent date de 1885, lorsque les puissances
impériales l’ont divisé, créant des pays arbitraires et dysfonctionnels qui
sont restés depuis en place. « Les Africains eux-mêmes », note French
acerbement, « n’ont pas été consultés ».
French n’évite pas la complicité
impitoyable de nombreux dirigeants africains dans la traite négrière, qu’il
attribue à l’absence d’une identité africaine unificatrice et à une soif
déchaînée de soies importées, de palanquins, d’armes à feu et de rhum produit
au Brésil par leurs anciens frères. Il cartographie le coût dévastateur du
dépeuplement, des guerres régionales chaotiques, des déplacements internes, de
l’érosion de la confiance sociale et de l’héritage non quantifiable qu’il
décrit de manière émouvante comme « l’écho obsédant d’une blessure que
l’on porte à travers les générations ».
« Born in Blackness » est
animé d’anecdotes personnelles, mais les lecteurs à la recherche d’un récit
captivant seront déçus. French tourne à plusieurs reprises sur son matériel
comme un restaurateur d’images révélant un monde perdu alors qu’il insiste calmement
pour que nous réécrivions l’histoire. J’ai trouvé le livre brûlant, déconcertant
et essentiel.
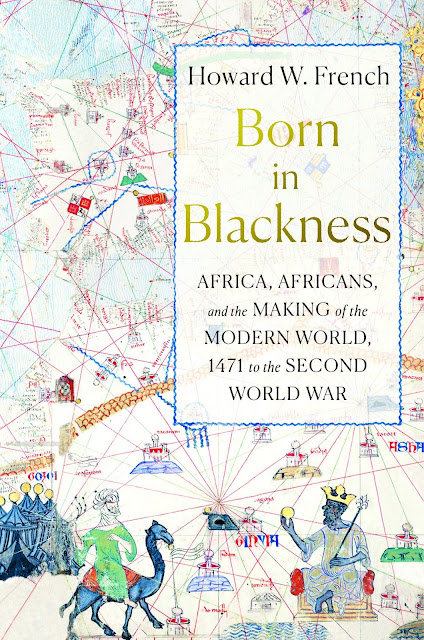

Comments
Post a Comment